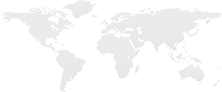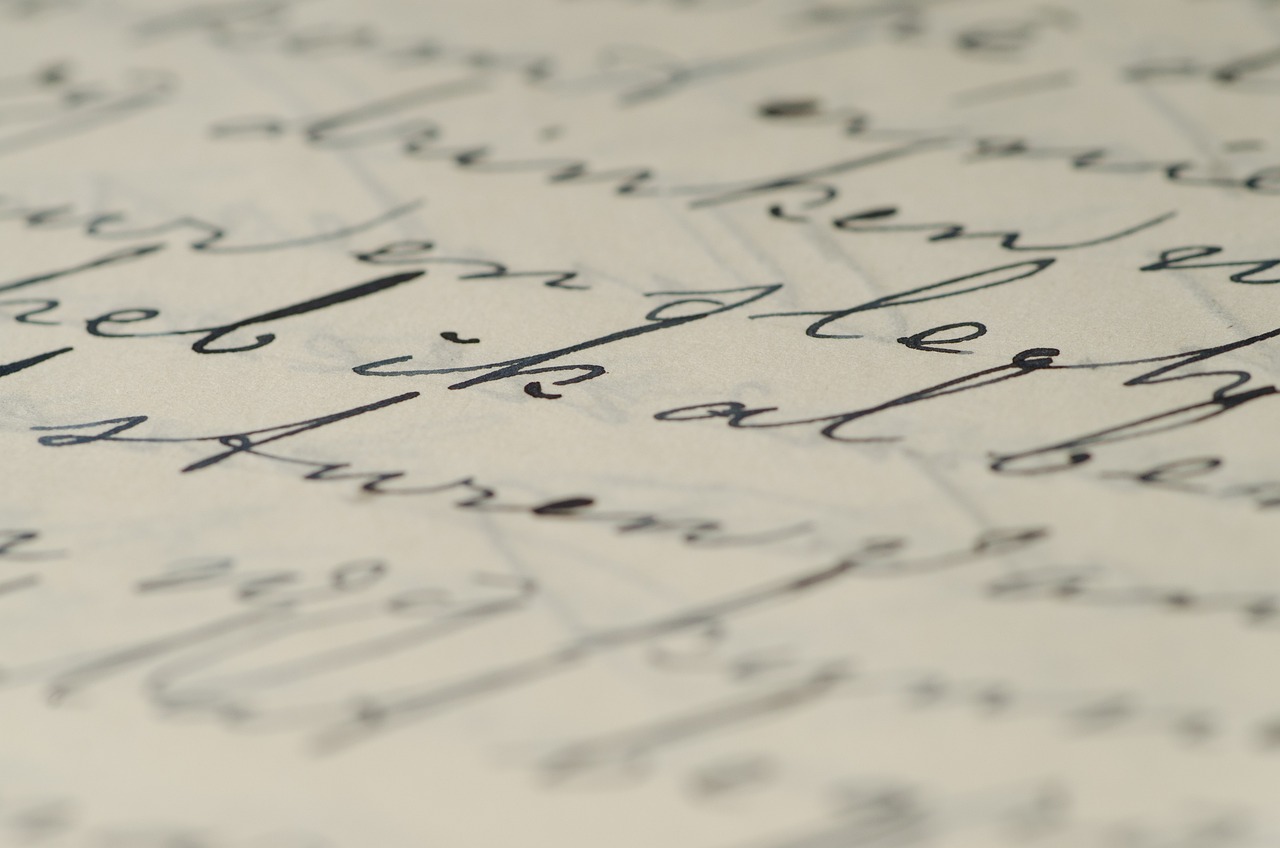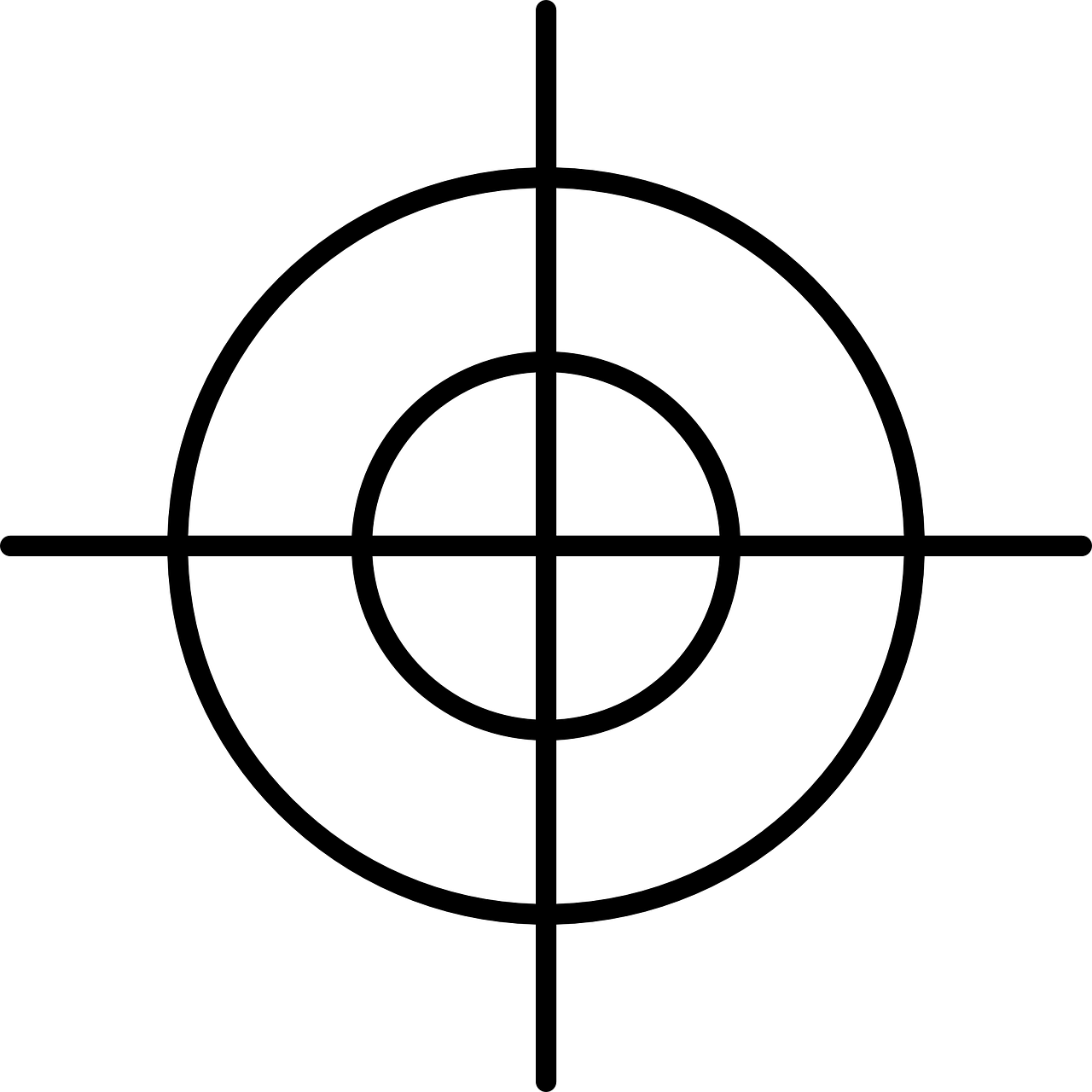Fraude et plateformes : dangers sur les droits sociaux
Alors que le gouvernement a annoncé au printemps 2023 son plan de lutte contre toutes les fraudes, le volet des fraudes sociales comprend une mesure phare : le précompte par les plateformes des cotisations sociales des travailleurs.
Un moyen, porté depuis plusieurs années par la Fédération nationale des autoentrepreneurs, de pallier la non-déclaration ou la sous-déclaration des revenus, particulièrement importante dans ce secteur d'activité d’après le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS).
Or la fraude sociale entraîne de facto une réduction des cotisations sociales versées : un manque à gagner pour l’Etat, certes, mais surtout une mise en danger à court, à moyen et à long termes de la protection sociale des travailleurs indépendants, population déjà très fragile !
Autour de 60 % de cotisations sociales éludées
L’Observatoire du travail dissimulé, piloté par le Haut Conseil du financement de la protection sociale, a publié fin 2022 un rapport sur l’état des fraudes sociales, qui réunit omissions intentionnelles (fraude) et erreurs de déclaration.
Dans la famille des microentrepreneurs (dont le caractère serait très « fraudogène » selon ce rapport qui estime à 43 % les cotisations sociales éludées en moyenne soit un manque à gagner estimé entre 1 Md€ et 1,5 Md€ en 2021), le secteur des travailleurs de plateformes est particulièrement visé avec des cotisations éludées qui avoisineraient 58 % pour les livreurs et 62 % pour les chauffeurs VTC.
La fraude, grande faucheuse des droits sociaux
La fraude a de multiples conséquences, des simples (mais potentiellement lourdes) pénalités financières à la négation du principe de solidarité qui est le socle même de notre pacte social. Si elle permet au travailleur d’engranger un peu plus d’argent sur l’instant, elle favorise le travail dissimulé, l’exploitation des travailleurs.
Des conséquences concrètes pour les travailleurs de plateforme
La réduction ou la dissimulation des revenus déclarés réduit les cotisations sociales versées et donc les droits sociaux créés, par exemple en cas d’accident, d’hospitalisation ou dans le domaine de la retraite.
C’est sur les revenus déclarés et les cotisations versées que sont calculées de nombreuses prestations sociales :
- les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident ou de maternité/paternité ;
- la durée d’assurance vieillesse
- le montant des pensions de retraite ;
- les droits au chômage et le montant des allocations versées ;
- la Prime d’activité.
Les revenus servent aussi de référence par exemple pour :
- obtenir un prêt bancaire, personnel ou professionnel ;
- louer un bien immobilier.
Accompagner et informer
L’amélioration de la protection sociale des indépendants travailleurs de plateformes passe aussi, incontestablement, par un accompagnement et une sensibilisation des travailleurs aux conséquences à terme de la non ou de la sous déclaration.
Le prélèvement à la source
Les montants déclarés par les travailleurs de plateformes et les montants déclarés par les plateformes elles-mêmes (une obligation mise en place par la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude) montrent un différentiel notable.
Face à ce constat, le HCFiPS a proposé, relayant d’ailleurs une proposition faite par la FNAE et l’Urssaf depuis plusieurs années, de mettre en place un prélèvement à la source. Un système déjà proposé en 2020 dans le rapport de Jean-Yves Frouin (Réguler les plateformes numériques de travail).
La réforme prévue dans le prochain Projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) concernant la collecte et le paiement des cotisations sociales par les plateformes va se déployer en 3 temps :
- 2024 : ouverture d'un guichet de régularisation amiable des dettes sociales, donc sans pénalité, soit à l'initiative des microentrepreneurs eux-mêmes soit de l’Urssaf ;
- 2026 : la déclaration du chiffre d’affaires des microentrepreneurs sera assurée par les plateformes ;
- 2027 : le précompte des cotisations et charges sociales sera assuré par les plateformes ainsi que leur versement directement à l’Urssaf (le travailleur percevra un montant net de cotisations sociales).